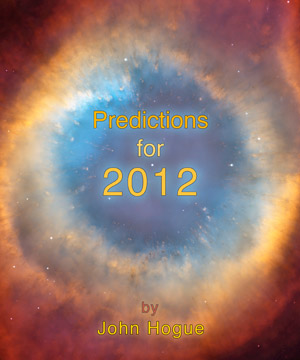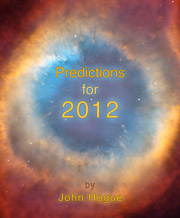Comment identifier un corpus marqué par l’emprunt ? En principe, on ne prend conscience qu’il y a emprunt que lorsque l’on découvre la source de l’emprunt, que l’on a identifié le « prêteur », même si celui-ci n’a pas donné son consentement ou n’est pas informé. On peut alors parler de piratage, de plagiat. Mais il nous semble que la situation d’emprunt peut être constatée même en l’absence - du moins dans un premier temps - de la connaissance l’original, car il y a des stigmates, des symptômes assez caractéristiques. Prenons un exemple venu de l’économie. Si dans un pays, il y a des voitures mais aucune usine pour les fabriquer, c’est qu’elles sont importées. Il se pose donc un problème de cause à effet. On n’a pas toute la chaîne, il y a des maillons manquants dans l’enchainement conduisant au « produit », il y a discontinuité. On a un produit « fini » mais dont certaines étapes de formation font défaut.
Quand la source est identifiée, la différence devient nettement plus flagrante. Dans le corpus-source, les articulations sont bien plus nombreuses, on suit mieux l’évolution, la progression des choses, que ce corpus se situe en amont ou en aval car un emprunt peut servir à étoffer rétroactivement un corpus plus ancien que le corpus-source. C’est là un paradoxe : l’emprunt bouscule parfois la logique diachronique et génère une aporie spatiotemporelle. Parfois, cependant, le corpus « empruntant » vient compléter le corpus « prêteur » quand celui-ci s’est corrompu ou a subi des modifications : le nombre de cas où des traductions sont tout ce qui reste d’un état d’origine est bien connu. Mais souvent, les deux corpus viennent ainsi se compléter. L’emprunt prend alors toute sa valeur pour l’historien. C’est ainsi que l’anglais actuel a emprunté historiquement à l’ancien français des tournures qui n’existent plus en français moderne, il les a perpétuées. Pour appréhender la formation d’un corpus, il est donc essentiel d’en extraire, d’en localiser les emprunts, tant ceux qu’il a effectués que ceux qu’il a subis.
Mais que se passe-t-il quand l’emprunt est devenu méconnaissable, quand il s’est de facto démarqué de sa source ? Cesse-t-il d’exister ? Nous dirons d’une part qu’il subsiste toujours des éléments relatifs au dit emprunt, ne serait-ce que partiellement et que d’autre part, la perte de conscience de l’emprunt, notamment sous une forme à la provenance opaque, empêche le savoir en question d’évoluer, de se renouveler, du fait d’un processus d’incrustation. Un tel élément ne peut être remplacé puisqu’il est marqué par une idiosyncrasie qui le rend incomparable. Il ne ressemble à rien de connu, donc l’emprunteur est renforcé dans la fausse idée que cet élément lui est consubstantiel.
Dans l’absolu, tout emprunteur peut faire ce qu’il veut de qu’il emprunte et lui imprimer sa marque ; mais en même temps, cela n’en restera pas moins un corps étranger et plus ou moins décalé. Il convient évidemment de distinguer ce dont nous héritons par filiation génétique, naturelle et ce que nous recevons du fait d’un certain environnement culturel venant se surajouter. Bien évidemment, toute une méthodologie est nécessaire pour débrouiller chaque écheveau, au cas par cas, mais en cela consiste le travail du chercheur dans un certain nombre de domaines.
Quels sont les traits qui dénotent de l’existence d’un emprunt ? Le caractère discontinu du corpus qui peut certes être dû à l’existence de pièces manquantes. Si l’on identifie de telles pièces du puzzle qui font défaut à une période plus ancienne ou plus tardive, il importe de s’interroger et en tout cas de le signaler.
Quelle est la fonction de l’emprunt ? Remplir un vide. Souvent l’emprunt sert à produire des contrefaçons d’autant qu’il est lui –même en soi une forme de faux. On a l’exemple devenu classique des Protocoles des Sages de Sion, réalisés, à l’extrême fin du XIXe siècle, à partir d’un pamphlet de Maurice Joly, paru trente ans plus tôt. On parlera de croissance externe et non interne, comme dans le cas d’une entreprise en rachetant une autre.
Rien n’est plus remarquable, il semblerait, que le cas où l’emprunt emprunte à un emprunteur. Retour à l’envoyeur. Or, quoi de plus tentant que d’emprunter à un corpus qui visait justement à rechercher une certaine patine du temps, que d’emprunter à ceux qui ont, par exemple, fait, sous la Ligue, du faux Nostradamus, en orchestrant sa renaissance, pour les prendre au mot ? Les pistes s’entrecroisent et l’on comprend que d’aucuns s’y perdent.
Nous nous intéressons tout spécialement à un cas de figure assez particulier mais qui pourrait finalement apparaître comme beaucoup plus fréquent qu’on ne pourrait le croire. Il s’agirait en quelque sorte de prêts plus que d’emprunts. On prête à tel auteur des textes qu’il n’a pas écrits, on introduit au sein d’un savoir des données qui n’en font pas partie au départ. On réécrit l’histoire d’une époque en se servant d’éléments qui lui sont étrangers. Et ensuite, les historiens entérinent ce type de stratagème, ce qui fausse les perspectives.
II Application au champ-nostradamologique».
Dans un premier temps, les libraires de la fin du XVIe siècle récupèrent le personnage de Nostradamus (1503-1566). Mais dans un deuxième temps, les biographes de Nostradamus, dont le plus récent est Denis Crouzet (Nostradamus, Payot, 2011), récupèrent, sans en avoir d’ailleurs conscience, les éditions ligueuses des années 1580-1590, pour les intégrer dans leur représentation de la vie de l’auteur, sous le prétexte qu’existent des éditions datées du vivant de Nostradamus (1555, 1557 ou suivant de peu sa mort, 1568). Ce faisant, ils perturbent considérablement la chronologie bibliographique des éditions centuriques. Bien entendu, le biographe sérieux ne saurait tomber – et faire tomber ses lecteurs - dans certains pièges tendus des siècles plus tôt. Il devrait en tout cas prendre toutes les précautions dans ce sens et tenir compte des avertissements émanant de certains chercheurs, plus vigilants ; pour le moins, il se doit de signaler à ses lecteurs les doutes exprimés à cet endroit.
Revenons plus en détail sur le cas des fausses éditions centuriques, qui est un cas d’école et au sujet duquel les historiens, en ce début de XXIe siècle, continuent de s’opposer, plus de 400 ans après les faits. Nous avons deux séries :
- une série A, constituée de diverses éditions datées – au regard des pages de titre – des années 1588 à 1590.
- une série B, constituée d’éditions datées au vu des pages de titre - mais non du fait d’une méthodologie rigoureuse - des années 1555 à 1568.
En apparence, la série B serait issue de la série A. En fait, c’est le contraire qui s’est produit, la série A ayant emprunté voire n’existant que par son emprunt à la série B. C’est bien là tout le débat.
On observe que la série A, pour ce qui est des éditions 1555 (Macé Bonhomme) et 1557 (Antoine du Rosne [Budapest et Utrecht, du nom des bibliothèques qui les conservent]) comporte trois versions correspondant à des états différents ; respectivement :
1 (1555) à 4 centuries, dont la IVe à 53 quatrains seulement,
2 (1557) à 7 centuries, dont 99 quatrains pour la VIe, et 40 à la VIIe,
3 (1557) à 7 centuries, dont 99 quatrains pour la VIe plus un avertissement latin, et 42 quatrains à la VIIe.
Pour celui qui n’a pas pris ou voulu prendre connaissance de la série B, quelles observations néanmoins peut-il déjà effectuer concernant la série A ? Contextuellement, ces éditions – et mieux encore leur contenu - ne sont pas attestées, il y a là un « trou » dans la documentation historique en dépit du fait que celle-ci est relativement abondante : on dispose de dizaines d’almanachs et de pronostications tant signés Nostradamus, autant en imprimés qu’en manuscrit (Recueil des présages prosaïques, voir note 19), – y compris chez les faussaires de l’époque – que signés d’autres auteurs ; on connaît diverses attaques contre Nostradamus ; on a retrouvé des dizaines de lettres de et à Nostradamus (cf. Lettres Inédites, présentées et traduites par Jean Dupébe, Droz, 1983). On dispose pourtant de recensions bibliographiques comme celles de M. Chomarat (1989) et de R. Benazra (1990), très extensives, et la recherche s’est poursuivie vainement depuis 20 ans.
Iconographiquement, ces éditions ne comportent pas les mêmes vignettes en page de titre que celles qui sont attestées dans les pronostications de Nostradamus des mêmes années 1550. Mais ces diverses vignettes ont un air de famille avec les dites vignettes authentiques et ressemblent surtout fortement à celles des faux almanachs parisiens, faussement signés Nostradamus (chez Barbe Regnault) des années 1560. On observe également des similitudes entre une pronostication (de Sconners) parue chez Antoine du Rosne en 1558 et les éditions centuriques censées parues chez le même libraire, mais là encore, des différences sensibles dans le dessin sont à constater.
Bibliographiquement, aucune édition centurique n’est attestée, en tant que telle, du moins au regard de sa date au titre, entre 1568 et 1588. Là encore, il y a un « trou ».
Éléments externes aux éditions centuriques cautionnant toutefois l’existence d’éditions dans les années 1550-1560 :
- 1. Les Prophéties d’Antoine Couillard, Paris, 1556, qui reproduisent des passages du texte de la Préface centurique de Nostradamus à son très jeune enfant César.
- 2. La mention d’une « centurie seconde » dans les Significations de l’Éclipse qui sera le 16. septembre 1559 (Paris), signées Nostradamus, comportant la même vignette normalement réservée aux Pronostications de Nostradamus.
- 3. L’épître de Jean de Chevigny à Larcher, en tête d’un texte de Jean Dorat sur la naissance d’un Androgyn, Lyon 1570, avec un quatrain dûment signalisé selon la pratique des éditions centuriques.
- 4. Les Prophéties à la Puissance Divine et à la Nation Française, Lyon, 1572, attribuées à Antoine Crespin, comportant des « adresses » dont le contenu recoupe celui de dizaines de quatrains issus des dix centuries (et pouvant correspondre aux éditions Benoist Rigaud 1568 à dix centuries).
5 La Bibliothèque d’Antoine Du Verdier, contenant le catalogue de tous ceux qui ont escrit, ou traduict en françois, & au-/ tres dialectes de ce royaume, ensemble leurs oeuvres imprimes & non impri-/ mees, l'augument de la matiere y traictere, quelque bon propos, sentence, doctri-/ ne, phrase, proverbe, comparaison, ou autre chose notable tiree d'aucunes d'icel-/ les denures, le lieu, forme, nom, & datre, ou, comment, & de qui elles ont este mi-/ ses en lumiere. Aussi y sont contenus les livres dont les autheurs sont incertains./ Avec un discours sur les bonnes lettres, servant de Preface/ Et à la fin un supplement de l'epitome de la bibliotheque de Gesner. Lyon, Barthélémy Honorat, 1585, ouvrage qui mentionne à la notice consacrée à Nostradamus « Dix Centuries de quatrains, Benoist Rigaud 1568. »
Ces divers documents ont fait l’objet d’analyses de notre part. Dans les cinq cas, il semble bien que l’on ait affaire à des contrefaçons ou de confusions entre titre et contenu, ce qui témoigne du zèle des faussaires et/ou des bibliographes pronant l’authenticité des dites éditions au moyen de conclusions insuffisamment fondées sur la base d’un terme (prophéties, centurie, quatrain, un nom propre) auquel on accorde une signification qu’il ne revêt pas nécessairement dans le contexte. Le simple fait de trouver un quatrain dans un texte ne suffit pas à démontrer qu’existait alors une édition des centuries, dès lors que ce quatrain n’est pas référencé selon la codification canonique (tel quatrain de telle centurie. Il ne faut pas oublier en effet que les centuries ont été amenées à récupérer des documents antérieurement constitués, y compris sous la forme de quatrains. Le cas emblématique est celui des sixains de Morgard, parus vers 1600, qui vont être intégrés peu après dans le corpus nostradamique. Ce n’est probablement pas un cas unique et cela vaut pour les emprunts probables, dans les annnées 1580-1590, à un Antoine Crespin et quelques autres comme Cormopéde, tout en sachant que ces auteurs ont certainement été eux-mêmes inspirés par le modèle nostradamique, à la suite de la reparution vers 1584 des quatrains des almanachs de Nostradamus. C’est la fable de l’imitateur imité. Dans le cas de Crespin, c’est vraiment saisissant. Que l’on songe que ses Prophéties, datées de 1572 comportent une première adresse au Roy commençant ainsi : « Estant assis de nuict secret estude, seul reposé sur la selle d’arain, flambe exigue sortant de solitude, faict proféré qu’il n’est à croire vain », ce qui correspond au quatrain (I, 1) lequel inaugure l’ensemble des livres centuriques. On sait que ce quatrain est inspiré directement ou non de Jamblique.. Le mot Branches du quatrain qui fait suite, évoque le personnage de Branchos, autour de la question des oracles. Mais le quatrain, quant à lui, sous la forme qui est la sienne semble bien être de Crespin et aurait donc servi pour la fabrication du premier groupe de quatrains, dont nous savons (cf l’édition de Rouen 1588) qu’il n’était pas encore classé en centuries et donc pas encore numéroté de la façon qui s’imposera par la suite.
Il ne faut pas oublier que si ce sont de fausses éditions tardives datant de la période « B », elles ont été vraisemblablement réalisées à partir de données empruntées à ce qui tourne autour de Nostradamus, de son temps, notamment en ce qui concerne la dimension matérielle. C’est ce qui vient singulièrement compliquer la recherche.
Bien évidemment, si le chercheur qui ne connaissait que la série A prend connaissance de la série B, d’autres réflexions ne sauraient manquer de se présenter à son esprit, s’il est de bonne foi. En effet, la série B comporte des chaînons manquants dans la série A.
On observe l’existence de chaînons intermédiaires entre 1555 et 1557 :
des éditions Paris 1588 qui comportent l’indication d’une addition après le 53e quatrain qui termine l’édition Macé Bonhomme,
les mêmes éditions comportent en leur titre, mais pas en leur contenu (ce point ayant été éclairci par nous ailleurs) l’annonce d’une addition pour 1561 de 39 « articles » à une « dernière centurie » qui ne semble pouvoir être autre que la VIe, se terminant par l’avertissement latin : Les Prophéties (..) reveues & additionnées par l’Autheur pour l’an mil cinq cens soixante & un de trente-neuf articles à la dernière centurie.
- l’édition Anvers 1590 qui comporte 35 quatrains à la VIIe et qui semble donc précéder l’édition 1557 à 40 quatrains à la VIIe,
tout cela viendrait donc s’intercaler entre l’édition Macé Bonhomme 1555 et l’édition Du Rosne 1557 Utrecht, comportant l’avertissement latin entre la VIe et la VIIe centuries (cette dernière à 42 quatrains à la VIIe), bien entendu, nous simplifions ; mais on observe, sur cette base, qu’étrangement l’édition 1557 serait « postérieure » à l’édition 1561 puisqu’elle comporte déjà les quatrains de la VIIe Centurie. Comment expliquer un tel phénomène ? Un revirement dans la politique des libraires, préférant in fine produire des éditions antidatées abouties et qui l’auraient été dés 1557 voire dès 1555, si l’on en croit les dernières lignes de l’édition 1590 Anvers, à 7 centuries, se référant à une édition 1555 comparable, non retrouvée. Inversement, les éditions antidatées viennent elles-mêmes compléter la chronologie des éditions ligueuses dont elles sont très vraisemblablement issues. Notons l’observation de Patrice Guinard (in « L’appareil iconographique des éditions Macé Bonhomme » (site Espace Nostradamus. N°135) : « L’édition d’Anvers, à sept centuries, ne peut reproduire une édition de 1555 qui n’en contenait que quatre. ». C’est révélateur d’une méthode qui consiste à réduire le corpus nostradamique aux exemplaires qui nous sont parvenus.
Conclusion : de la responsabilité des historiens
On peut raisonnablement se demander si les principaux complices des faussaires ne sont pas les historiens qui reconstituent le cours des choses à leur façon ou plus largement si ce n’est pas le regard rétrospectif qui fausse quelque peu les perspectives. Il est bien probable qu’au départ, et c’est assez flagrant dans le cas de l’astrologie, il ne s’agissait que d’ajustements de l’astrologie à telle ou telle imagerie liée au contexte dans lequel elle était reçue – et l’on sait que l’astrologie a traversé les périodes et les cultures les plus diverses. Mais précisément, en restant par trop marquée par son passé, elle devint de moins en moins capable de s’adapter à de nouvelles époques, c’est probablement cela son drame et la cause de sa marginalisation, du fait de la sclérose de ses emprunts qui n’étaient plus reconnus comme tels. Il suffit d’interroger de nos jours les astrologues pour constater qu’ils sont terriblement attachés à ce qui n’aurait dû faire sens que ponctuellement. Certes, il est des astrologues qui ont tenté de se démarquer, mais ils n’ont fait le travail qu’à moitié, conservant notamment un découpage numérique qui les empêchait de procéder à des emprunts plus modernes, devant ainsi se contenter de demi-mesures. On ne se sert plus du nom des signes ou des planètes mais on garde néanmoins les 12 secteurs et l’on prend en compte toutes les planètes, passées, présentes et à venir. Ce qui est excusable de la part d’astrologues ou de nostradamologues qui ne sont historiens que d’occasion, l’est beaucoup moins, en revanche, chez des historiens «professionnels » qui devraient montrer l’exemple. Or, le problème actuel, dans les domaines en question, c’est de noter à quel point les historiens de métier commettent les mêmes bévues que les apprentis historiens apologètes et somme toute produisent des textes du même ordre, les uns s’accompagnant d’une riche bibliographie, les autres échouant à replacer les choses dans leur contexte ; quitte à se référer à des périodes plus tardives que celles du corpus considéré, dans la mesure même où l’emprunt peut aussi bien viser le passé que le futur quand il est réalisé après coup. Car ce qui est assez étrange, ici, c’est que l’on contracte ainsi des emprunts a posteriori, pour le compte de personnes qui n’en demandaient point tant. Aussi bien l’astrologie que Nostradamus auront souffert, l’un comme l’autre, d’une « modernité » appliquée rétroactivement. Or l’historien tend trop souvent, encore de nos jours, à croire que l’on ne peut emprunter qu’à ce qui existe déjà et non à ce qui est encore à venir. Mais le passé n’est-il pas une reconstruction permanente, qui se nourrit d’un certain anachronisme ? Il y a là, en tout cas, un obstacle épistémologique dont il faut absolument prendre conscience. Si Nostradamus s’est vu ainsi doté d’éléments biographiques fantaisistes et contrefaits qui sont venus éclipser sa vie réelle, au point que certains auteurs n’hésitent pas à lui dénier le titre d’astrologue, au vu des seules Centuries, qui sont l’arbre qui empêche de voir la forêt. L’astrologie, quant à elle, n’est plus perceptible sinon à travers le prisme zodiacal, à travers le panthéon mythologique, à travers le thème natal, dont les historiens s’accordent à ce qu’il émerge tardivement dans son « évolution », autant de facteurs qui sont venus se greffer sur elle et qui semblent en être indissociables, au point d’empêcher de saisir l’astrologie en son noyau dure, en son « tronc », ce qui hypothèque son statut scientifique. Dans le cas de Nostradamus, en principe, il semble relativement aisé de faire la part des choses, au vu des documents qui nous sont parvenus, mais il reste que ceux-ci cohabitent avec des contrefaçons comportant les mêmes dates, sur la base notamment des épîtres qui les introduisent (Préface à César, 1555, Adresse à Henri II, 1558). Dans le cas de l’astrologie, les choses sont plus complexes du fait qu’il est plus délicat de dégager le point de départ, sauf à considérer que c’est tout simplement le système solaire. D’aucuns ont cru y trouver la solution à cette problématique des origines, mais la solution semble bien être devenue le problème. Certes, dans l’absolu, l’astrologie est née d’une certaine approche de l’astronomie, on peut même dire qu’elle a « emprunté » à l’astronomie ce dont elle avait besoin mais avant toute chose, l’astrologie est une réflexion sur le cosmos, et plus spécifiquement au départ sur le cycle soleil-lune, connu de très longue date, bien avant que l’on apprenne à distinguer entre planètes et étoiles qui ne faisaient qu’un dans les représentations les plus anciennes. De là est née, selon nous, une numérologie liée à l’écoulement du temps, autour de certains nombres, dont le principal fut probablement le 7 (d’où son importance dans l’Ancien Testament : Sept jours de la Création, respect du repos du septième jour, alternance sept ans et sept ans, etc.). Certaines coïncidences semblent avoir introduit quelque confusion : le découpage du cycle annuel en 4 saisons est-il un fait en soi ou est-il calqué sur les quatre temps du rapport lune-soleil, l’importance du septénaire (luminaires plus cinq planètes) n’est-elle pas tributaire de ce nombre 7, étant donné que les luminaires ne sont pas de même nature que les planètes ? On a vite fait d’inverser les rapports et de placer au départ les saisons et les planètes. Or, il nous semble que c’est là littéralement un contresens. Quand on a compris que le 7 est le paradigme d’une numérologie, l’on comprend alors que l’on soit allé chercher le 7, le moment venu, quand le phénomène planétaire fut mis en évidence, du côté de Saturne, en tentant de faire de cette planète, la plus lointaine connue jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, une sorte de Lune supérieure, parcourant un tapis d’étoiles fixes. Que l’on ait été tenté de « structurer » son parcours en recourant au nombre 12, qui était déjà à la base du rapport lune-soleil, quoi d’étonnant si ce n’est que là n’était pas l’essentiel. En cela, une telle division ne constitue pas une structure matricielle de l’astrologie mais un facteur de structuration qui n’existe que par ce à quoi il s’applique, lequel facteur peut être remplacé par d’autres – comme le dispositif des maisons qui n’était pas nécessairement à 12 secteurs mais à 8, surtout lorsqu’il n’est plus maîtrisé au niveau de sa dimension cyclique pour ne plus être qu’une suite de « symbol